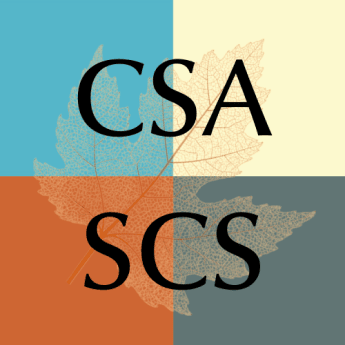En mémoire : Dr Guy Rocher
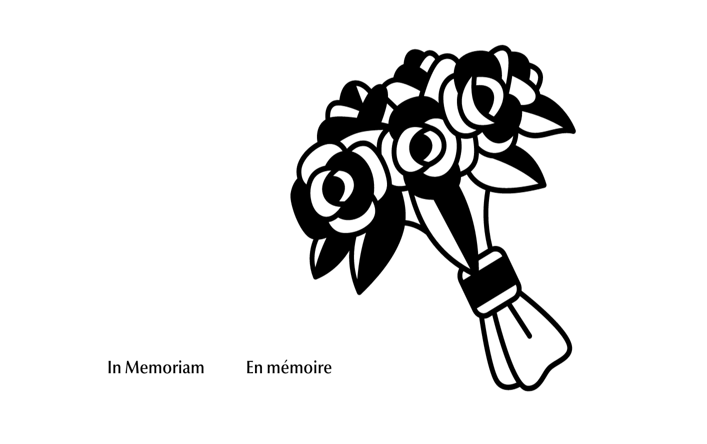
Rocher Rech Soc 26 sept 2025
Guy Rocher (1924-2025), sociologue et intellectuel public
Simon Langlois
La vie du sociologue Guy Rocher, décédé à Montréal à l’âge de 101 ans en 2025, s’est étendue en parallèle à un siècle de mutation sociale qu’a connue la société canadienne-française refondée en société québécoise au mitan de sa trajectoire personnelle. Il fût à la fois témoin attentif, analyste chevronné et acteur engagé des profonds changements sociaux qui ont transformé le Québec. Ses étudiants, ses diplômés, ses collègues et ses collaborateurs ont été unanimes à souligner sa gentillesse et son caractère doux et respectueux de ses interlocuteurs, sans oublier son ouverture au débat et la fermeté de ses principes de même que « l’élégance et la force tranquille de sa pensée » (Gérard Bouchard). Il était animé par l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité chères à Max Weber, un auteur dont il a maintes fois souligné l’importance en sociologie et qui fut pour lui une source d’inspiration.
Guy Rocher a défendu ses idées et ses convictions au cours de sa présidence de la Jeunesse Étudiante Catholique (JEC) et durant sa carrière comme professeur : revendication de la justice sociale, nécessité de l’égalité des chances en éducation, promotion de la langue française, plaidoyer pour l’autonomie et la souveraineté de la nation québécoise, défense de la laïcité dans l’espace public. Il n’élevait pas le ton et sa parole forçait l’écoute de son propos, tant en privé qu’en public et dans les médias. Sa maitrise de la langue française et de la langue anglaise a alimenté sa réputation d’excellent communicateur. Sa pensée était claire et articulée et il s’exprimait sans jargon en avançant des arguments fondés.
Guy Rocher fut un grand sociologue doublé d’un intellectuel public et d’un homme d’action, ce dernier trait lui ayant valu le qualificatif justifié de « révolutionnaire tranquille » dans plusieurs témoignages parus au lendemain de son décès. Trois dimensions de sa longue carrière méritent de retenir notre attention : d’abord son œuvre scientifique qui a été une importante source d’inspiration pour des génération d’étudiants et de chercheurs en sciences sociales, ensuite sa contribution à la vie publique et aux institutions (membre de la commission d’enquête sur l’éducation, sous-ministre dans le cabinet de Camile Laurin, etc.) et enfin ses idées et ses engagements intellectuels. Guy Rocher fut un professeur apprécié et il avait la réputation d’être un pédagogue attachant d’abord à l’université Laval en 1952 et ensuite à l’université de Montréal à partir de 1960. Les deux dernières dimensions sont mieux connues (je les regrouperai dans les lignes qui suivent) et j’insisterai en premier lieu sur l’œuvre du sociologue.
L’œuvre scientifique de Guy Rocher
Au tout début de sa carrière, Guy Rocher fut un pionnier dans l’analyse de la stratification sociale de l’ancien Canada français. Lorsqu’il était professeur à l’université Laval, il avait préparé le « code Rocher », une typologie originale des strates sociales inspirée de la sociologie américaine de l’époque. Sa première recherche empirique a porté sur une analyse comparée de la mobilité sociale des francophones et des anglophones du Québec dont les résultats furent publiés dans son premier article co-signé avec Y. de Jocas. Cette première contribution ouvrait la voie à ses travaux axés sur le changement social, une constance dans son œuvre, mais elle a aussi alimenté sa volonté d’agir afin de mettre fin à l’infériorité économique des Canadiens français, la grande question sociale qui se posait à l’époque de son entrée dans la vie active.
Guy Rocher a dispensé pendant de nombreuses années le cours Introduction à la sociologie à des milliers d’étudiants et d’étudiantes (les classes étaient nombreuses à l’époque) et il en a tiré un ouvrage original (publié initialement en trois tomes), Introduction à la sociologie générale (1969-1971), son « opus magnum ». Le plan du livre était fort original et il tranchait avec ses pendants américains en étant centré sur de grandes questions appelant une réponse en sociologie : comment se réalise l’attachement des individus à la société, comment se structurent les cadres sociaux et comment s’effectue le changement social. Le premier tome porte sur l’action sociale (avec un exposé clair sur la pensée de Talcott Parsons et des références aux sociologues français et allemands), le second tome considère l’organisation sociale et le troisième aborde le changement social et l’évolution des sociétés. Rocher y présente les concepts et théories classiques en sociologie, « loin du dogmatisme et des filtres idéologiques » comme l’ont souligné de nombreux commentateurs de l’ouvrage. Ce dernier a bien vieilli et il fut mis au programme pendant des années dans un grand nombre de départements de sociologie non seulement dans la francophonie mais aussi dans plusieurs pays en étant traduit dans plus d’une dizaine de langues (le compte reste à établir).
Guy Rocher avait fait son doctorat en sociologie à l’Université Harvard sous la direction de Talcott Parsons, alors le sociologue américain le plus influent, promoteur du structuro-fonctionnalisme et auteur « difficile à lire » de l’avis unanime. Dans son livre Talcott Parsons et la sociologie américaine publié à Paris en 1972, Rocher s’était donné comme objectif de faire connaître la pensée du sociologue américain et de la synthétiser d’une manière claire et accessible, deux qualités qui ont été soulignées par ses collègues. Le sociologue britannique très en vue à l’époque Anthony Giddens avait même qualifié l’ouvrage de « plus clair que ceux de Parsons lui-même » dans un compte rendu paru dans British Journal of Sociology, 27, 2, 1976, p. 273). L’ouvrage a été traduit en cinq langues d’après la compilation de P. Duchesne. Rocher ne se considérait pas comme un disciple de Parsons ni comme un « structuro-fonctionnaliste » étant plutôt partisan d’une analyse de l’action sociale s’inspirant de Max Weber qui a orienté la rédaction de son Introduction à la sociologie. Il a toujours donné une grande place à l’individu en situation sociale, comme le montre son grand intérêt pour l’étude du changement social tout en reconnaissant l’importance des structures sociales alimentée par sa lecture d’Émile Durkheim.
On doit à Guy Rocher de nombreuses analyses portant sur les mutations de la société québécoise dont il fut un observateur bien informé tout en étant lui-même impliqué dans l’action qui orientait ces mêmes changements sociaux comme on le verra plus loin. Gérard Bouchard résume bien son apport. « Fait remarquable, il [Guy Rocher] fut l’un des premiers à formuler la plupart des idées fondatrices à partir desquelles les scientifiques de ma génération ont pensé le Québec pendant des décennies » (G. Bouchard 2006 : 326). Son livre Le Québec en mutation (1973) regroupe onze essais éclairants sur la francophonie nord-américaine, le Canada, l’éducation, la révolution culturelle, les idéologies, le déclin et le renouveau du religieux, le métier de sociologue. Les thèmes abordée, nombreux et touchant plusieurs sphères de la société, témoignent de l’étendue de ses champs d’intérêts. De cet ouvrage, je retiens qu’il a révélé « le décalage qui s’est produit au Québec dans l’évolution des structures sociales et de la culture » depuis le 19e siècle (p. 15). Les structures économiques, les structures de classes ou les structures familiales ont changé plus rapidement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle que l’univers culturel (religion, idéologies notamment).
Dans les vingt-cinq dernières années de sa carrière, Guy Rocher s’est attaché à la sociologie du droit. Il « appartenait à une famille établie dans le Droit » (Guy Rocher 1974 : 243) et il avait dans sa jeunesse brièvement étudiée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, sans oublier qu’il a maintes fois rappelé l’importance du droit chez les premiers sociologues. Lors de son passage au Conseil exécutif du Gouvernement du Québec entre 1976 et 1981, il avait constaté comment « le droit était le bras de l’État ». « Pour s’intéresser aux réformes, il fallait s’intéresser à l’État d’abord, parce que l’État est un des lieux où aboutissent bien des réformes. (…) et il faut aussi s’intéresser au droit, mais ce n’est pas le cas des sociologues » (G. Rocher en réponse à F. Rocher 2010 : 68-69). Guy Rocher s’est lui-même défini comme un réformiste animé par une volonté de changement social, l’un des grands axes de la sociologie qu’il a bien théorisé et analysé dans son œuvre comme on le verra plus loin.
Afin de pallier ce manque d’intérêt pour le droit chez ses collègues, le sociologue a ouvert ce nouveau chantier de recherche en entrant au Centre de recherche en droit public (CRDP) de l’Université de Montréal à un âge où d’autres envisagent leur retraite de la vie active. L’apport de Guy Rocher à la sociologie du droit reste à étudier et mériterait d’être mieux connu. Faute d’espace, je soulignerai quelques éléments de son travail. Le sociologue a toujours distingué le rôle de l’État et le rôle du législateur. Il remettait en cause le stéréotype qui avance que le droit retarde sur la réalité et il a distingué l’efficacité et l’effectivité du droit. L’efficacité renvoie à l’intention du législateur mais l’effectivité évoque des dimensions sociologiques et même la morale. Ainsi, l’interdiction de fumer ou l’obligation du port de la ceinture en auto ont eu besoin d’être acceptées par des normes et par le contrôle social pour devenir effectives. A contrario, l’acceptation des lois sur la langue française ou sur la laïcité est plus difficile pour des raisons qu’il a expliquées. Il s’est aussi appliqué à cerner les dimensions mythiques du droit, donnant l’exemple de la Loi 101 sur la langue française qui a largement contribué à la redéfinition de la société québécoise. Il en va de même pour la charte des droits et libertés de la personne qui a acquis la grande valeur symbolique et identitaire que l’on sait au Canada. Une autre contribution de sa sociologie du droit a consisté à analyser les rapports entre le droit objectif et le droit subjectif. Il a avancé l’idée que l’invocation de droits subjectifs avait ouvert la porte au droit objectif dans la mesure où l’État a été forcé à répondre à une demande croissante. La catégorisation des droits subjectifs (des enfants, des minorités, des immigrants, etc.) a contribué à la prolifération du droit dans une relation circulaire et dialectique entre les droits subjectifs et le droit objectif. Rocher s’est aussi attardé à l’étude des paradoxes entre la liberté et la contrainte imposée par le droit. « La liberté a constamment besoin d’être redéfinie par le droit en même temps que le droit multiplie les contraintes et fixe les limites de cette liberté » (G. Rocher en réponse à F. Rocher, 2010, p. 219).
Guy Rocher, « le révolutionnaire tranquille »
L’étude du changement social a occupé une place centrale dans l’œuvre de Guy Rocher, comme on vient de le voir, tant sur le plan empirique que sur le plan théorique. Il y avait consacré le troisième tome de son Introduction générale à la sociologie et il avait critiqué la sociologie de Talcott Parsons à qui il reprochait le peu de place accordée au changement social dans sa construction théorique. Or, Guy Rocher fut aussi lui-même un homme d’action très engagé dans l’orientation de plusieurs changements sociaux qui ont eu cours au sein de la société québécoise durant sa vie active. Il s’est défini comme un réformiste, je le rappelle, à l’époque (années 1960 et 1970 en particulier) où plusieurs de ses jeunes collègues en sciences sociales penchaient plutôt vers des changements révolutionnaires. La première caractéristique d’une réforme est d’être un changement planifié et une réforme repose d’abord sur un projet, a-t-il précisé dans son Itinéraire (1974). Rocher partageait avec d’autres chercheurs et intellectuels de sa génération – je pense en particulier à Gérald Fortin, son collègue sociologue du département de sociologie de l’université Laval – cette perspective inspirée par ce qu’on pourrait appeler l’idéologie de la planification s’appuyant fortement sur l’État. Il fait partie de la génération des intellectuels et des technocrates qui ont amené l’État québécois à s’éloigner d’un pôle défensif (protéger les traditions, la foi, la langue des Canadiens français, ou encore défendre « notre butin » selon l’expression de Maurice Duplessis) au profit d’un pôle actif menant à la modernisation des institutions et à des interventions dans le développement économique telles que la nationalisation des compagnies hydro-électriques ou les incitations à faire émerger le Québec Inc. dans le monde des affaires. La pensée et l’action de Guy Rocher ont été marquantes dans trois sphères de la vie publique québécoise : la réforme du système d’éducation, la défense de la langue française et l’appui à la laïcité dans l’espace public.
Rocher a passé cinq années comme membre influent de la Commission d’enquête sur l’éducation (Commission Parent) au début des années 1960 et ses idées furent déterminantes dans les orientations que proposèrent les commissaires d’après plusieurs témoignages. Il a milité pour l’application des connaissances empiriques sur l’éducation et l’enseignement dans l’élaboration des recommandations de la Commission Parent et il fut un important promoteur de la création des Cegeps visant à remplacer les collègues classiques sans oublier la création de l’Université du Québec à Montréal. « Quand, dans les années 1960, on a fait la réforme du système d’enseignement au Québec, on a fait une réforme si radicale que, par métaphore, on l’appelle une révolution » (G. Rocher en réponse à F. Rocher 2010, p. 70). Par la suite, le sociologue n’a jamais délaissé ses premières préoccupations pour la réforme du système d’enseignement et il a maintes fois critiqué l’instrumentalisation de l’éducation et les rapports inégalitaires qu’il y observait, mettant en cause à l’occasion les dérives vers l’élitisme. Il militait pour la gratuité au sein du système scolaire dans les ordres d’enseignement jusqu’à l’université, comme le montre son appui au mouvement étudiant de 2012 donné à un âge avancé.
La promotion de la langue française au Québec fut le deuxième champ d’engagement de Rocher. Appelé par le ministre Camille Laurin à occuper le poste de sous-ministre au développement culturel dans le premier gouvernement de René Lévesque (1970-1979), il a contribué à la rédaction de la Charte de la langue française avec Fernand Dumont et Henri Laberge et à l’élaboration de la Loi 101 sur la langue française, sans oublier sa collaboration à la rédaction du livre blanc sur le développement culturel qui exerça une grande influence sur les politiques publiques du Québec. Le sociologue a par la suite expliqué « son passage de l’identité de Canadien français à celle de Québécois » de même que son engagement envers l’indépendance du Québec. Le constat de l’anglicisation des enfants d’immigrants dans le système scolaire montréalais fut déterminant dans l’évolution de sa pensée. « L’adjectif ‘canadien-français’ symbolisait notre statut minoritaire dans un Canada multiculturel, un pays où la minorité canadienne-française a été ramenée en 1971 au rang de toutes les autres minorités. Cette prise de conscience a fortement contribué à ce que je devienne indépendantiste » (G. Rocher en réponse à F. Rocher 2010 : 56).
Plus tard dans sa longue carrière, le sociologue Rocher s’est impliqué cette fois comme intellectuel public dans son appui à la laïcité. Il a défendu la vision républicaine qui implique la neutralité des institutions étatiques et notamment l’interdiction des signes religieux chez les enseignants, les juges et les policiers dans l’exercice de leurs fonctions afin d’assurer la confiance du public. Il s’est montré critique des accommodements raisonnables portant sur les différences religieuses. Dans ses interventions publiques, Rocher avança que la laïcité n’était pas un principe hostile aux religions mais plutôt une condition essentielle pour que toutes les croyances, spirituelles ou non, puissent coexister dans une même société. Selon lui, la laïcité rend possible la diversité des convictions tout en assurant l’unité de la société et elle vise à éviter que les appartenances religieuses ne deviennent des facteurs de discrimination ou de division.
Tout au long de sa vie active – et même à un âge très avancé – Guy Rocher est intervenu dans les médias afin de commenter et d’analyser dans une perspective critique de nombreux enjeux de société. Je n’évoquerai qu’un seul exemple de son engagement public, un peu lointain dans les mémoires mais fort important, soit celui de sa contestation de la Loi des mesures de guerre adoptée en 1970 par le gouvernement fédéral de Pierre Elliot Trudeau lors de la Crise d’Octobre. Il avait alors présidé le « Comité des huit » formé d’intellectuels – comprenant Fernand Dumont (université Laval), Charles Taylor (McGill University), deux journalistes (Claude Ryan et le père Vincent Harvey) et trois chefs syndicaux – tous engagés dans la contestation de cette loi limitant les libertés individuelles dans un contexte social hautement émotif. Sa prise de position lui valut d’être longuement interrogé par la police (la GRC) dans son bureau de l’université de Montréal.
*****
Avec le décès de Guy Rocher, la société québécoise a perdu un brillant intellectuel et un homme d’action dévoué et engagé dans la promotion de la justice sociale et impliqué de près dans de nombreux changements sociaux inspirés par sa perspective réformiste qui a eu par moment une connotation proche d’une perspective révolutionnaire. La sociologie comme discipline scientifique, à laquelle il était si attachée, a de son côté perdu un important pionnier qui laisse un héritage fondamental et précieux.
Références
Pour en savoir davantage sur l’homme et l’œuvre, on pourra se reporter d’abord à un texte autobiographique de Rocher, « Itinéraire sociologique » (1974), à deux autres textes (2005, 2006) et aux deux tomes de l’excellente biographie du sociologue qu’a rédigée Pierre Duchesne (2019 et 2021). Deux ouvrages d’entretiens avec Guy Rocher sont parus, l’un avec Geores Khal (1989) et l’autre avec François Rocher (2010). À signaler enfin le liber amicorum préparé par Céline St-Pierre et Jean-Philippe Warren (2006), publié après la retraite du professeur et qui contient un court texte autobiographique.
Bouchard, Gérard
« L’homme, le savant, le citoyen…et les autres » dans Céline Saint-Pierre et Jean-Philippe Warren (dir.) 2006, p. 325-328.
Duchesne, Pierre
Guy Rocher. Voir, juger, agir. Tome I (1924-1963), Montréal, Québec Amérique, 2019.
Guy Rocher. Le sociologue du Québec. Tome II (1963-2021), Montréal, Québec Amérique, 2021.
Rocher, Guy
(avec Yves de Jocas) «Inter-generation occupational mobility in the province of Quebec», Canadian Journal of Economics and Political Science, 1, 1957: 57-68.
« Itinéraire sociologique », Recherches sociographiques, volume XV, numéros 2-3, mai-août 1974 : 243-248.
Introduction à la sociologie générale, tomes I, II et III, Montréal, HMH, 1969-1972.
Talcott Parsons et la sociologie américaine, Paris, Presses universitaires de France, 1972.
Le Québec en mutation, Montréal, Hurtubise HMH, 1973.
Entre les rêves et l’histoire. Entretiens avec Georges Khal, Montréal, VLB éditeur, coll. Études québécoises, 1989.
« Le ‘polythéisme’ des modes d’explication du social », dans Daniel Mercure (dir.), L’analyse du social. Les modes d’explication, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005 : 21-45.
« Être sociologue-citoyen », texte paru dans Céline Saint-Pierre et Jean-Philippe Warren (2006 : 8-17).
Rocher, François
Guy Rocher. Entretiens, Montréal, Boréal, 2010.
Saint-Pierre, Céline et Jean-Philippe Warren (dir.)
Sociologie et société québécoise. Présences de Guy Rocher, Montréal, Les presses de l’Université de Montréal, 2006.